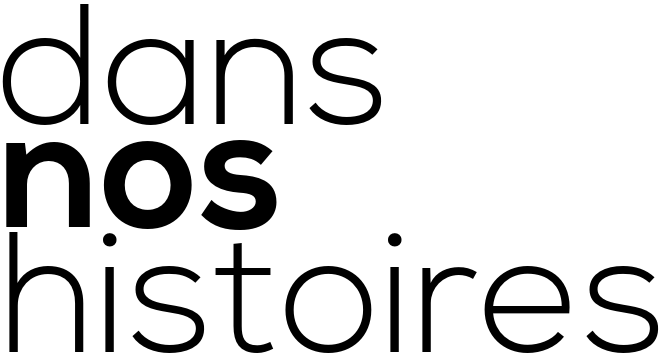une clef, ça ne te dit rien ?
Pierre Tevanian
Les premières pages de Mulholland Drive. La clef des songes de Pierre Tevanian.
Au sens propre comme au figuré, Mulholland Drive est un film à clef. Il y a d’abord, dès le commencement, cette mystérieuse clef bleue trouvée par les deux héroïnes au fond d’un sac. Plus profondément, il y a le fait que cette clef elle-même doit être pensée, interprétée, déchiffrée par les spectateurs et spectatrices du film pour résoudre un mystère – et même plusieurs. Le mystère d’abord de l’identité perdue d’une des deux héroïnes devenue amnésique, pour qui la clef bleue est, avec une liasse de billets (trouvée au fond du même sac) et le double souvenir d’un nom de lieu (Mulholland Drive) et d’un nom de personne (Diane Selwyn), la seule trace à partir de laquelle une histoire peut être reconstituée. Il y a ensuite ce mystérieux contrat de meurtre qui semble planer sur elle, et dont en ouverture du film elle a provisoirement réchappé. Enfin il y a le mystère que construit le film lui-même : un agencement de séquences en elles-mêmes intelligibles mais sans rapport manifeste entre elles, ni en termes d’enchaînements logiques ni d’un point de vue affectif, puisque les registres les plus hétérogènes se juxtaposent ou se mélangent. Le film a commencé comme un thriller mais il divague très vite dans tous les sens, épouvante, comédie loufoque, mélodrame d’amour : aucun fil évident ne permet de relier l’enquête ludique que mènent les deux héroïnes Betty et Rita, leurs rapports comiques avec une sympathique gardienne d’immeuble (Coco Lenoix) ou avec une inquiétante voisine (Louise Bonner), le cauchemar terrifiant d’un jeune client du café Winkie’s, les déboires tragicomiques d’un cinéaste (Adam Kesher) avec son directeur de casting puis son nettoyeur de piscine, les revers d’un tueur à gages maladroit, ou encore la présence fantomatique d’une espèce de Mafia et l’inquiétante étrangeté d’un cowboy qui semble en être le messager, et enfin l’atroce découverte d’un cadavre dans un appartement de Sierra Bonita, jusqu’à ce paroxysme du mystère que constitue le spectacle donné dans un théâtre nommé Silencio, à mi-chemin entre magie et farce macabre.
Si chaque segment nous passionne en lui-même, sous diverses modalités (l’angoisse, la terreur, le rire), une autre strate d’émotions et de pensée nous rend doublement captifs : quelque chose comme un supplément d’inquiétude, et donc de questionnement, est produit par cette absence même de connexions entre les différents fragments qui défilent. Il y a, pour le redire avec ce mot, une clef qui manque et qu’instinctivement nous recherchons : quel lien regroupe ces personnages qui semblent ne pas se connaître, ces intrigues étrangères les unes aux autres et pourtant enchevêtrées, et ces gammes d’affects tellement dissonantes ?
Au-delà même de cet enchaînement inexpliqué d’intrigues disparates, le paradoxe, la contradiction, l’inquiétante étrangeté se manifestent également à l’intérieur de chaque scène : les séquences les plus nombreuses, celles qui impliquent les deux héroïnes Betty et Rita, ont ceci de déroutant qu’elles sont vécues ensemble mais sous une modalité absolument opposée. Une rencontre inopinée dans un appartement, un coup de téléphone à la police, la visite d’une voisine, tout est vécu par Betty avec une légèreté, une insouciance, un optimisme, une gaieté imperturbable et presque excessive, et par Rita au contraire dans une gravité et une terreur tout aussi étonnante. D’où vient cette énergie vitale surabondante qui porte Betty, et de quels abîmes revient Rita pour être à ce point défaite, disloquée, diminuée ? Quels démons ou quelle malédiction fuit-elle pour être à ce point apeurée ? Telles sont les questions que nous nous posons confusément, et qui nous rendent rapidement attentifs au moindre détail, avides de clefs explicatives.
La recherche d’une clef s’impose plus encore après deux heures de film lorsque, dans un récit jusque-là énigmatique mais ne sortant presque jamais du strict réalisme, viennent tout à coup, inexplicablement une fois de plus, se multiplier des événements surnaturels : tout d’abord l’apparition magique d’une boite bleue dans le sac de Rita, puis la disparition tout aussi magique de Betty, puis de Rita, puis de la boîte elle-même, puis la réapparition de Tante Ruth dans un appartement qu’elle était censée avoir laissé à sa nièce Betty. Après quoi le mystère prolifère plus encore : nous voyons Betty se réveiller dans un nouvel appartement, sous une autre identité, celle de Diane Selwyn, la morte, et nous retrouvons Rita, qui se nomme désormais Camilla. Diane est aussi ténébreuse que Betty était rayonnante, et Camilla aussi sûre d’elle que Rita était apeurée. Le cinéaste Adam Kesher revient lui aussi métamorphosé : aussi triomphant qu’il était piteux jusque-là, et surtout connecté désormais aux deux héroïnes (il les dirige toutes les deux dans un film, et il épouse Camilla), ainsi qu’au personnage de Coco, qui est désormais sa mère. C’est en fait l’ensemble des personnages que nous voyons revenir sous de nouvelles identités, dans de nouveaux rôles, tous reliés désormais avec le personnage de Diane. Le cowboy et le chef de la Mafia deviennent ses convives lors d’une fête sinistre à Mulholland Drive. Quant au tueur, c’est elle-même qui le convoque et le paye… pour faire assassiner Camilla. Toute cette fin de film, jusqu’à son dénouement horrible, appelle une explication qui manque cruellement : une clef.
Si tout le film fait signe vers une clef manquante, ce n’est pourtant pas cette clef, ni même son absence, qui fait sa force. La prolifération finale de changements d’identité, d’inversions de situations et de connexions nouvelles entre les personnages nous laisse dans un état de tournis et d’incompréhension, mais elle n’empêche pas d’être touché, bouleversé même, par ces fragments que nous voyons défiler trop vite. Si nous ne comprenons pas les connexions entre ces fragments, et moins encore la logique des déplacements et des retournements de la dernière demi-heure, nous en comprenons assez en tout cas : nous saisissons des morceaux d’histoires qui sont en eux-mêmes intelligibles et émouvants – ceux de la fin du film en particulier, qui nous montrent, avec une immense empathie, avec une immense délicatesse, l’effondrement, la détresse, la souffrance d’un être (Diane) que nous avions pendant deux heures connu (sous le nom de Betty) comme le personnage fort, joyeux, solaire, d’une histoire tout au plus étrange, tordue et vaguement inquiétante.
Ce n’est donc pas la clef explicative elle-même qui, comme dans certains films à suspense ou à coup de théâtre, donne au film tout son intérêt. Ce n’est pas non plus la recherche de cette clef explicative qui le rend jouissif ou captivant. C’est plutôt l’inverse : c’est le caractère troublant, inquiétant puis poignant du peu que nous comprenons qui génère le besoin impérieux, presque moral, d’en savoir plus, de comprendre vraiment de quoi il a retourné. C’est parce que le peu qu’on a saisi a suffi à nous faire aimer les deux héroïnes que nous devenons à notre tour, à l’issue du film, des enquêteurs : nous devons comprendre de quoi elles sont mortes, comme si elles étaient nos propres sœurs.